
Sommaire
Introduction au choix d’une structure de mémoire (2 ou 3 parties)
Choisir la bonne architecture de mémoire est un levier décisif pour la clarté de votre argumentation, la qualité de votre démonstration et, in fine, votre note. Entre le plan en 2 parties (très répandu, lisible, rapide à exécuter) et le plan en 3 parties (plus ambitieux, propice à la nuance), la décision dépend de votre problématique, de vos données, de vos consignes universitaires et de votre temps.
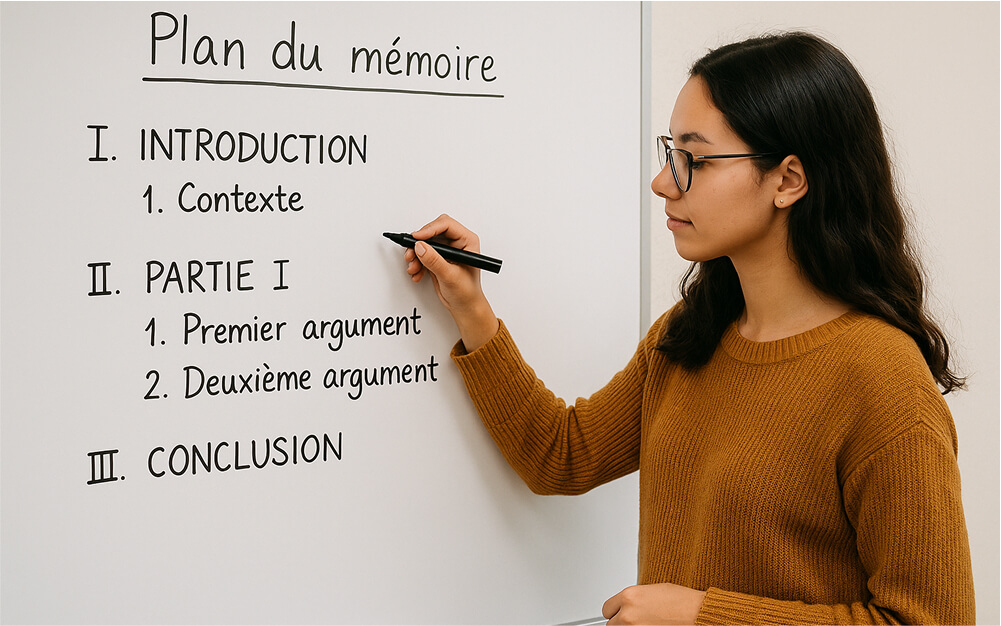
Ce guide vous livre une méthode pas à pas, des exemples par discipline (marketing, RH, droit, data, santé…), des mini cas pratiques, des tableaux comparatifs en dégradé bleu, ainsi que des listes d’astuces et d’erreurs à éviter pour livrer un plan cohérent, argumenté et fluide. Objectif : vous permettre de choisir la structure la plus performante pour votre sujet et vos objectifs.
Pourquoi le plan de mémoire influence directement votre note finale ?
Le plan n’est pas un habillage formel : c’est la charpente logique de votre démonstration. Il guide votre lecteur (le jury), structure vos idées, balise vos transitions, et fait gagner du temps de rédaction. Un plan solide réduit les répétitions, favorise la progression argumentative et met en valeur vos résultats.
Selon le Guide de présentation des mémoires – Université de Montréal de l’Université de Montréal (2022), une structuration claire et équilibrée « favorise la cohérence argumentative et la compréhension du lecteur ».
- Lisibilité — Exemple : en droit, un plan en 3 parties qui isole la méthodologie de la discussion permet au jury d’identifier immédiatement où se situent les critères d’interprétation et sur quelle base ils sont appliqués.
- Rigueur — Exemple : en psychologie, une P1 centrée sur des modèles validés (stress, coping) et une P2 qui applique un protocole standardisé rendent la P3 (discussion) crédible et reproductible.
- Efficience — Exemple : en sciences sociales, un plan 2P « théorie → analyse » évite les redites et accélère la rédaction quand les données sont limitées (10 entretiens).
- Évaluation — Exemple : un plan 2P net facilite la correction : un correcteur peut cocher plus vite les critères (problématique, méthodo, limites) car tout est regroupé.
Comment choisir entre un plan de mémoire en 2 ou 3 parties ? (Méthode en 5 étapes)
- Clarifiez la problématique — Exemple : en RH, « Comment la transparence salariale impacte-t-elle l’attractivité employeur ? » (mesurable via candidatures et taux d’acceptation). Comme le rappellent Beaud & Weber (2010, Guide de la recherche en sciences sociales), le choix de la structure dépend étroitement du type de question de recherche et du dispositif empirique envisagé.
- Cartographiez vos matériaux — Exemple : en marketing, dressez la liste : 1 revue de littérature, 1 questionnaire (n=150), 2 entretiens managers, accès aux métriques CRM.
- Estimez les volumes — Exemple : ciblez 30 pages P1, 40 pages P2 ou, en 3P, 25/20/25 ; évitez 10 vs 40 pages.
- Évaluez l’ambition — Exemple : si vous menez un A/B test multi-variables + entretiens, la P2 « Méthodologie » d’un plan 3P devient nécessaire pour expliciter le protocole.
- Validez avec le directeur — Exemple : soumettez deux mini-fiches (2P vs 3P) avec titres H2/H3 et estimation de pages pour arbitrage rapide.
Le plan de mémoire en 2 parties : simple, clair et rapide à rédiger
C’est la structure la plus utilisée. Elle épouse une logique binaire très lisible : cadre théorique → analyse / application. Elle convient parfaitement aux mémoires de volume modéré, aux sujets centrés, et à ceux dont la collecte de données reste limitée.
Exemple de structure type en 2 parties (cadre théorique → analyse)
- Partie 1 — Cadre théorique : modèles, concepts, littérature, débats, hypothèses. Exemple : en finance, revue de la VaR, des stress tests, et hypothèses sur le risque sectoriel.
- Partie 2 — Analyse & recommandations : étude empirique, résultats, discussion, limites, pistes. Exemple : application de la VaR sur un portefeuille réel, interprétation et recommandations d’hedging.
Exemples de mémoires efficaces en 2 parties
- Marketing : 1) Théories du parcours client ; 2) Analyse de questionnaires + recommandations CRM (segmentation, nurturing).
- RH : 1) Modèles d’engagement ; 2) Étude d’un dispositif d’incentive en PME (KPIs : rétention, eNPS).
- Finance : 1) Littérature sur le risque de crédit ; 2) Test d’un score maison sur un échantillon (AUC, Gini).
- Psychologie : 1) Modèles de stress ; 2) Entretiens cliniques et pistes d’intervention (protocoles brèves).
Mini cas pratique : impact de la personnalisation des emails
Sujet : « Quel est l’impact de la personnalisation des emails sur le taux de conversion ? » — Partie 1 : théories de persuasion, preuve sociale, heuristiques. Partie 2 : A/B test (objet personnalisé vs neutre), résultats (p<.05), recommandations (ciblage, fréquence).
Lire aussi : comment rédiger le cadre théorique d’un mémoire
Le plan de mémoire en 3 parties : ambitieux, rigoureux et valorisant
Ce découpage s’inspire du modèle scientifique IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion), largement adopté dans les publications universitaires internationales (APA, 2020).
Le plan en 3 parties permet de détailler davantage la méthodologie et de séparer la discussion des simples résultats. Il est idéal si vous menez une étude complexe (expérimentation, protocole mixte, data volumineuse) ou si votre discipline attend un volet méthodo solide (santé, droit, data science).
Exemple de structure en 3 parties (contexte, méthode, discussion)
- Partie 1 — Contexte & cadre théorique : concepts, revue de littérature, hypothèses. Exemple : santé publique — cadres d’éducation thérapeutique.
- Partie 2 — Méthodologie & recueil des données : protocole, instruments, échantillon, limites. Exemple : RCT, critères d’inclusion, échelles validées.
- Partie 3 — Résultats, discussion & recommandations : analyses, interprétations, apports, perspectives. Exemple : effets cliniques significatifs, discussion des biais, recommandations opérationnelles.
Cas pratique : méditation en entreprise et charge mentale
Sujet : « Effets d’un programme de méditation en entreprise sur la charge mentale » — P1 : modèles du stress et interventions non-médicamenteuses. P2 : protocole (groupe contrôle, durée, échelles). P3 : résultats comparatifs, discussion des biais, recommandations RH.
Exemples concrets de plans de mémoire par discipline
1) Droit (plan 3 parties conseillé)
Problématique : l’articulation entre liberté d’expression et protection de la réputation en ligne.
P1 : textes, jurisprudence, doctrines.
P2 : analyse méthodique de cas (arrêts récents, critères).
P3 : grille d’évaluation, recommandations d’interprétation, pistes législatives.
Exemple : comparaison de deux arrêts opposés et extraction d’une grille à 5 critères pour trancher les cas futurs.
2) Data/IA (plan 3 parties conseillé si dataset riche)
Problématique : peut-on prédire la rotation du personnel avec un modèle interprétable ?
P1 : état de l’art churn RH, explainable AI.
P2 : pipeline (features, split, métriques).
P3 : résultats, SHAP pour l’explicabilité, recommandations managériales.
Exemple : matrice de coûts pour arbitrer entre précision et faux positifs en politique RH.
3) Marketing (2 parties si terrain limité / 3 parties si expérimentation)
Problématique : l’impact des avis vidéo sur l’intention d’achat.
Option 2P : théorie influence → A/B test simple + conseils.
Option 3P : théorie → protocole multi-plateformes → résultats + discussion biais.
Exemple : hausse de 12 % d’intention d’achat quand les avis sont authentifiés.
4) Santé (3 parties souvent requis)
Problématique : efficacité d’un protocole d’éducation thérapeutique dans le diabète de type 2.
P1 : cadres théoriques, recommandations.
P2 : protocole (cohorte, critères d’inclusion).
P3 : résultats, analyse clinique, limites, perspectives.
Exemple : réduction significative de l’HbA1c à 6 mois, mais effet plateau à 12 mois.
5) Sciences sociales (2 ou 3 selon l’ampleur)
Problématique : les effets du télétravail sur le sentiment d’appartenance.
2P : théories de l’attachement → entretiens thématiques.
3P : théories → méthodo mixte (quant+qual) → résultats & discussion.
Exemple : sentiment d’appartenance corrélé à la fréquence de feedback managérial.
Tableaux comparatifs : plan de mémoire en 2 parties vs 3 parties
Comparatif synthétique des plans de mémoire (2P vs 3P)
| Critère | Plan en 2 parties | Plan en 3 parties |
|---|---|---|
| Lisibilité | Très élevée, parcours lecteur direct — Exemple : utile pour un sujet très ciblé. | Bonne si bien équilibré — Exemple : essentiel quand la méthode est évaluée. |
| Temps de rédaction | Modéré, efficace — Exemple : mémoire M1 avec deadline courte. | Plus long — Exemple : étude clinique à protocole détaillé. |
| Adapté à | Mémoires courts / données limitées — Exemple : 8–12 entretiens. | Terrains riches / protocoles complexes — Exemple : RCT, datasets volumineux. |
| Valorisation de la méthode | Intégrée, mais moins détaillée — Exemple : simple questionnaire. | Partie dédiée — Exemple : méthode mixte quant/qual. |
| Risque principal | Perçu comme « classique » — Exemple : sujet très discipliné. | Déséquilibre des volumes — Exemple : P2 sous-dimensionnée. |
Lecture rapide pour choisir la structure selon vos contraintes.
Comparatif qualité de la démonstration dans un mémoire académique
| Dimension | 2 parties | 3 parties |
|---|---|---|
| Cohérence argumentative | Très bonne si problématique ciblée — Exemple : hypothèse unique testée. | Excellente avec protocole robuste — Exemple : plusieurs hypothèses liées. |
| Gestion des transitions | Simple (théorie → analyse) — Exemple : passage direct aux résultats. | Exigeante (théorie → méthodo → discussion) — Exemple : transitions méthodo soignées. |
| Granularité de l’analyse | Suffisante pour terrains modestes — Exemple : une seule source de données. | Fine, permet d’isoler les biais — Exemple : triangulation des sources. |
| Effet sur la soutenance | Clarté et impact rapide — Exemple : plan pitchable en 60 s. | Crédibilité scientifique renforcée — Exemple : questions du jury anticipées. |
Erreurs fréquentes dans la structuration d’un mémoire (et leurs solutions)
- Parties déséquilibrées — Exemple : P1=35 p., P2=12 p. → la discussion manque d’air. Solution : déplacer la revue « hors-sujet » en annexe, renforcer les résultats.
- H2/H3 trop vagues — Exemple : « Analyse des résultats » → préférez « Mesurer l’effet de X sur Y » ; le jury voit immédiatement l’objectif.
- Répétitions — Exemple : retours de méthodo recopiés dans la discussion. Solution : ne garder en P3 que ce qui interprète.
- Méthodo sous-dimensionnée — Exemple : protocole en 1 page pour une expérimentation complexe. Solution : passer en plan 3P et détailler l’instrumentation.
- Absence de limites — Exemple : pas de biais évoqués, notes sanctionnées. Solution : encadré « limites & biais » avec 3 points concrets.
- Pas d’encadrés — Exemple : texte massif. Solution : 2 tableaux (comparaison, métriques) + 1 note méthodo.
Astuces pratiques pour réussir la structure de votre mémoire
- Utilisez des verbes d’action — Exemple : en finance, « Mesurer le risque sectoriel » plutôt que « Analyse du risque ».
- Commencez par les introductions & conclusions de parties — Exemple : en RH, écrivez la conclusion de P2 pour cadrer vos résultats attendus.
- Planifiez des jalons — Exemple : P1 livrée J+7, P2 J+21, P3 J+35, soutenance blanche J+42.
- Matrice objectif → preuve — Exemple : « démontrer l’impact » → « test t, taille d’effet, intervalle de confiance ».
- Encadré « limites & biais » — Exemple : « biais d’auto-sélection », « taille d’échantillon ».
- Préparez vos visuels — Exemple : schéma « entonnoir de données » pour la méthodo. (Image : Carte mentale du plan final)
- Relisez à voix haute — Exemple : si la suite de H2 se lit comme une démonstration, le plan est cohérent.
- Pensez soutenance — Exemple : script de 60 s pour justifier le choix 2P ou 3P.
Quel est le meilleur plan de mémoire ? (comparatif final)
Le choix entre un plan en 2 parties et un plan en 3 parties dépend d’abord de votre problématique, de vos matériaux et des attentes de votre discipline. Si votre terrain est limité, la structure 2P maximise la lisibilité et la vitesse d’exécution ; si votre étude requiert une méthode détaillée et une discussion séparée, la 3P renforce votre crédibilité scientifique.
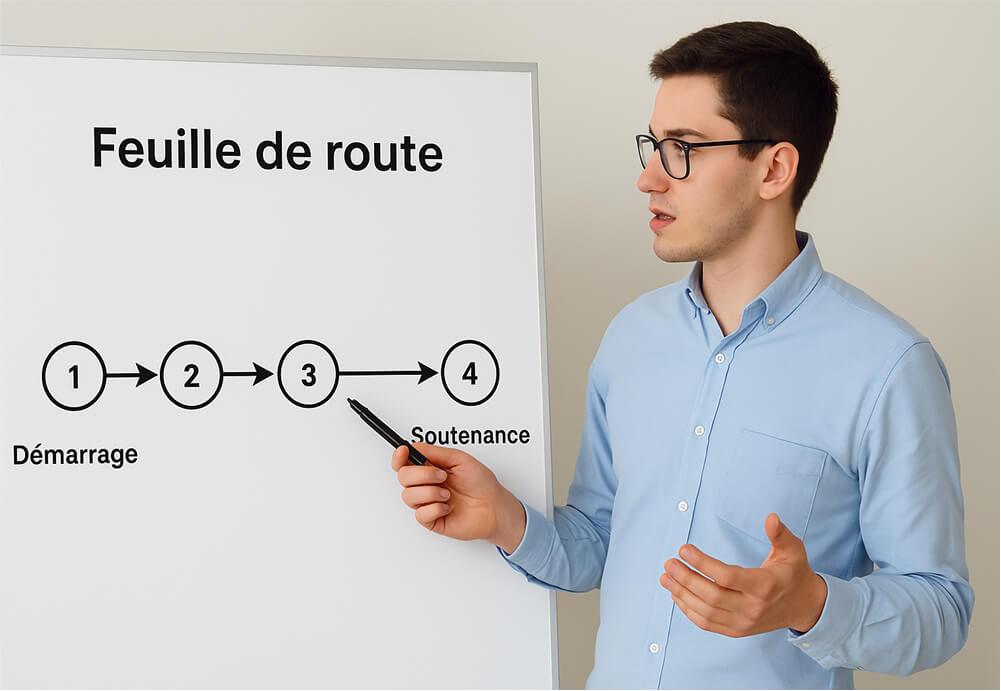
FAQ : plan de mémoire 2 ou 3 parties (réponses d’experts)
1. Le plan en 2 parties est-il accepté partout ?
Souvent oui, surtout pour des mémoires courts ou centrés. Vérifiez néanmoins les consignes de votre établissement.
2. Quand privilégier 3 parties ?
Quand la méthodologie est un enjeu majeur (expérimentation, étude clinique, data volumineuse) ou attendue par la discipline.
3. Comment éviter le déséquilibre des volumes ?
Établissez une grille indicative (pages/cibles) et recadrez dès qu’un écart dépasse ~20 %.
4. Peut-on changer de structure en cours de route ?
Oui, en le justifiant et en maintenant la cohérence argumentative. Informez votre directeur avant de basculer.
5. Les tableaux sont-ils vraiment utiles ?
Oui : ils densifient l’information, facilitent la comparaison et rendent le texte plus mémorable pour le jury.
6. Faut-il une partie « recommandations » séparée ?
Pas nécessairement : en 2 parties, intégrez-la en fin d’analyse ; en 3 parties, placez-la après la discussion.










